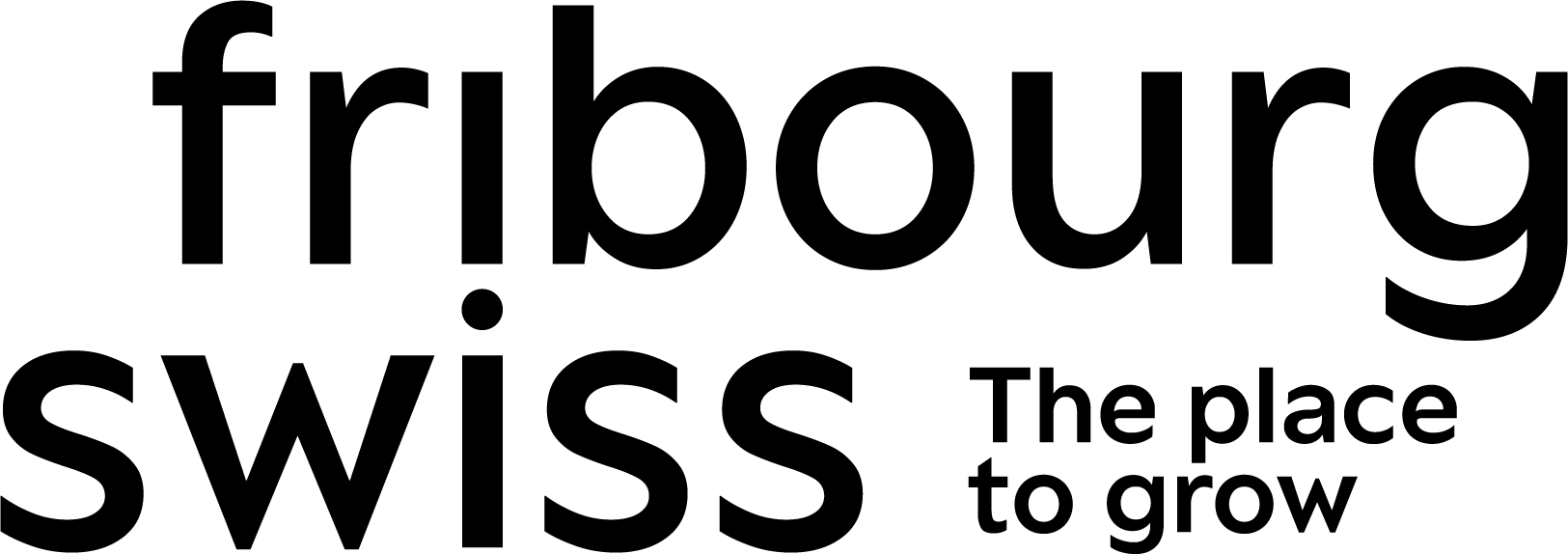Future docteure en marketing, enseignante expérimentée et professionnelle de l’hôtellerie, Mikèle Landry conjugue rigueur académique et sensibilité terrain. Après avoir notamment enseigné à l’Université de Fribourg et à l’Ecole hôtelière de Lausanne, elle a été promue en 2025 au poste de Head of Specialisation in Luxury Brand Strategy au sein du Bachelor en International Hospitality Business du Glion Institute of Higher Education (GIHE). Son approche du luxe, qu’elle partage avec les étudiants du Bachelor, se veut à la fois ancrée, critique et ouverte. Entretien autour des codes du luxe, du storytelling, de la responsabilité des marques et des enseignements qu’en tirent les PME.
Comment définissez-vous le luxe aujourd’hui, dans vos enseignements ou vos échanges avec les étudiants ?
Il n’existe pas une seule définition du luxe. Ce que j’essaie de transmettre aux étudiants, c’est la diversité des points de vue – issus de la littérature, des professionnels ou des consommateurs – et l’importance de repérer les critères récurrents. L’un des éléments les plus essentiels est la notion d’expérience : le luxe ne se résume ni à un prix élevé ni à une simple rareté, mais renvoie à un vécu global, qui commence bien avant l’achat et se prolonge après. Il engage les sens, les émotions, l’imaginaire. Sa valeur ne repose pas uniquement sur le produit ou le service, mais sur la relation, souvent hautement personnalisée, entre la marque et le client. Le luxe se construit aussi à travers des dimensions psychologiques (statut, différenciation) et symboliques (héritage, savoir-faire, univers de marque).
Comment aborde-t-on la notion de luxe avec une génération marquée par l’omniprésence du numérique ?
Nos étudiants sont très à l’aise avec le digital : ils maîtrisent les outils, connaissent les marques, leurs univers et leurs campagnes. Mais cette familiarité ne va pas toujours de pair avec un recul critique. Notre rôle est de les aider à dépasser la simple consommation d’informations, à comprendre les stratégies déployées, à articuler identité, segmentation et canaux de diffusion.
Dans le luxe, l’interaction personnelle reste fondamentale : le numérique ne doit pas remplacer l’humain, mais enrichir l’expérience sans en effacer la dimension relationnelle. Les étudiants apprennent à combiner digital et interaction personnelle – une compétence devenue essentielle, notamment en hôtellerie ou en communication.
Le storytelling, étroitement lié à l’expérience client, semble aujourd’hui aussi important – voire plus – que le produit lui-même. Qu’est-ce qui explique, selon vous, cette évolution dans le secteur du luxe ?
Cela répond à une attente croissante d’authenticité et de cohérence. Les consommateurs ne se contentent plus d’un bel objet : ils veulent comprendre ce que la marque incarne, percevoir un lien réel entre ses valeurs affichées et ses actions. Le storytelling devient alors un fil conducteur émotionnel, un vecteur d’identité.
Bien construit, il relie tous les points de contact avec le client, renforce la valeur perçue et crée un sentiment d’appartenance, même si le produit n’est pas objectivement unique. Certaines marques comme Cartier, Rolex, Patek Philippe ou de grands établissements hôteliers l’illustrent très bien : leur communication repose sur des récits cohérents, porteurs d’un imaginaire fort. Mais pour fonctionner, le récit doit s’ancrer dans la culture de la marque – un storytelling générique ne suffit pas.
Comment forme-t-on les étudiants au storytelling dans un univers aussi codifié que celui du luxe ?
On part de l’observation : quelles marques racontent bien leur histoire, pourquoi, comment ? Puis, les étudiants créent leurs propres narratifs. Ils apprennent à éviter les clichés, à rechercher la singularité, à faire le lien entre message et ADN de marque. Ce travail développe à la fois leur créativité, leur rigueur et leur capacité stratégique. Le storytelling devient un outil pour penser la marque dans sa globalité : vision, stratégie, différenciation, valeur créée.
Les PME fribourgeoises et suisses, avec des moyens plus limités, peuvent-elles malgré tout s’inspirer des codes du luxe ?
Absolument. Ce n’est pas une question de budget, mais de clarté. Une PME qui sait ce qu’elle représente, qui définit bien ses valeurs et les incarne de manière cohérente peut tout à fait construire une relation émotionnelle forte avec ses clients. Cela suppose de réfléchir à l’expérience vécue : que ressent concrètement le client ? Qu’est-ce qui dépasse l’acte fonctionnel ? Comment créer une relation privilégiée avec le client, afin qu’il garde un souvenir positif, unique et mémorable ?
Et comment aller plus loin dans cette logique, au-delà de la simple réponse à une demande ?
Le luxe, parfois, ne répond pas à un besoin immédiat : il crée le désir. Cette posture suppose une vraie clarté stratégique, une vision, des choix affirmés – même à contre-courant. Une PME peut penser comme une marque de luxe si elle assume ce qu’elle est, dans les moindres détails. L’essentiel, c’est la sincérité, la constance et l’attention portée à chaque interaction.
Quel regard portez-vous sur la responsabilité des marques de luxe aujourd’hui ? Pensez-vous qu’elles peuvent – ou doivent – incarner des valeurs comme la durabilité ou l’éthique ?
Elles le doivent. Nous sommes à un moment où des transformations profondes sont nécessaires, sur le plan environnemental comme social. Le luxe, en tant que secteur exposé et prescripteur, ne peut plus se contenter de compenser ou de communiquer : il doit intégrer les principes de durabilité au cœur de ses pratiques, dans la conception, la production, les partenariats et la gouvernance. Certaines marques montrent déjà l’exemple, en exigeant des engagements concrets de leurs fournisseurs. Mais ce n’est pas encore la norme. Elles ont aussi un rôle à jouer dans l’évolution des mentalités, en éduquant leurs clients et en s’appuyant sur le lien de confiance qu’elles ont su construire.
Quel rôle les jeunes générations, et notamment les étudiants de Glion, peuvent-elles jouer dans cette évolution ?
Un rôle central. Ce sont souvent eux qui portent cette transition, avec une conscience claire des enjeux. À Glion, ces thématiques sont abordées à la fois dans un cours dédié à la responsabilité d’entreprise et de manière transversale, tout au long du cursus. Nos étudiants quittent l’école avec les outils nécessaires pour agir et faire évoluer les pratiques. Ils sont les professionnels engagés de demain, porteurs d’un luxe plus responsable.